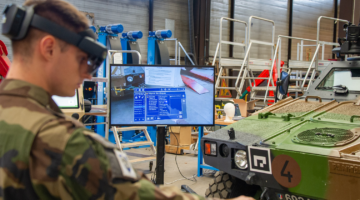Crédits photos © EMA / ECPAD
Planifier, dimensionner et acheminer les besoins au plus juste. Des procédures interarmées de montée en puissance en opération non encore établies.
Le 10 janvier au matin, mon adjoint et moi étions en train de rédiger une note expresse pour convoquer un groupe de travail interarmées pour travailler sur les procédures de montée en puissance et de mise sur pied d’une force. Le 10 janvier au soir, nous étions plongés dans Serval et nous n’avons pas eu le temps de terminer cette note express. Le premier défi auquel nous avons été confrontés n’est donc pas directement lié à Serval, mais nous l’avons pris de plein fouet pendant cette opération, puisqu’il est lié à l’interarmisation de la logistique. Ce processus d’interarmisation remonte en effet aux décrets de 2005, puis de 2009 : avant ces derniers, les armées disposaient en interne de leurs moyens logistiques propres, de leur commissariat, de leurs munitions, de leur maintenance. Si des structures, des organisations et des procédures ont été créées dans la foulée de ces décrets pour le « soutien vie » en métropole, telles que le Centre interarmées de coordination de la logistique en opération (CICLO), le Centre multimodal des transports (CMT), ou encore le Centre interarmées de l’administration en opération (CIAO), ainsi que les Groupes de soutien des bases de défense (GSBdD), il manque en revanche pour les opérations un certain nombre de procédures interarmées, qui n’ont pas eu le temps d’être consolidées en termes de conception et d’organisation. L’organisation fonctionne et a bien fonctionné, mais nos procédures ne sont pas encore fluides. Il nous a donc fallu régler certaines petites aspérités au fur et à mesure que nous devions projeter dans un délai très court une force volumineuse d’environ 4000 hommes : ce dont il faut avoir conscience est que nous avons projeté en trois semaines au Mali ce que nous avons mis dix ans à projeter en Afghanistan…
Nous avons projeté en trois semaines au Mali ce que nous avons mis dix ans à projeter en Afghanistan…
Harmattan est certes survenu après 2009, mais comme il s’agissait principalement d’une opération aérienne menée à partir de la métropole, les procédures de soutien étaient connues et les BDD ont parfaitement rempli leur rôle de coordination à ce moment-là pour assurer une projection adéquate de moyens. Le succès d’Harmattan, tant au niveau de l’opération que de son soutien, a montré que le système fonctionnait. En revanche, pour une projection de forces interarmées, un certain nombre de manques s’est fait sentir, simplement parce que nous n’avions pas eu le temps d’aller au bout de notre logique. De fait, la doctrine interarmées du soutien et de la logistique en opération, la DIA4, est sortie environ un mois après le déclanchement de Serval. Il s’agit en effet de processus de travail assez longs en raison du nombre important d’interlocuteurs concernés – les trois armées et leurs treize sous-fonctions logistiques – dont il faut harmoniser les positions en fonction des budgets, des personnels et des états-majors. Il faut que chacun soit bien en phase et fonctionne en synergie et cela prend du temps. Ce qui explique que lorsque Serval s’est déclenché, toute cette procédure n’était pas encore tout à fait au point, cette intervention en soulignant encore davantage le besoin impératif. Nous avons donc continué à utiliser par défaut les procédures de l’armée de terre, laquelle a représenté pendant de nombreuses années 80% des forces projetées et disposait d’un processus de montée en puissance parfaitement bien rodé. Hormis quelques rouages à huiler, nous avons retrouvé certains anciens reflexes. Une procédure interarmées aurait cependant pu accélérer certains aspects et les enseignements de Serval vont nous aider à la rédiger avec encore plus d’acuité. Il y a cependant peu de différence avec ce que nous envisagions de faire avant Serval, en ce sens que la logique de montée en puissance d’une force est la même : ce qui diffère sont les interlocuteurs, car avant les réformes, seuls le service de santé et le service des essences des armées fonctionnaient en interarmées, chaque armée ayant son commissariat, son service de maintenance ou encore son service de munitions. Avec les réformes, les interlocuteurs ont changé et la difficulté réside maintenant dans le calage de nouvelles procédures et l’accoutumance à une nouvelle chaîne de contacts.
Dimensionner les besoins d’une logistique expéditionnaire sans temps de planification
Avant la guerre des Malouines pour les Anglais, la guerre du Golfe pour nous, nous fonctionnions dans une logistique de corps d’armée face à l’ennemi blindé soviétique. Nous ne nous posions pas de question : nous avions tous les moyens de transport nécessaires pour pousser vers l’avant des stocks dimensionnés au niveau des régiments du Train à hauteur de sept jours de combat, quoiqu’il advienne. Les opérations de stabilisation et de maintien de la paix se fondaient quant à elles sur des dispositifs statiques et une logistique relativement fixe avec des opérations de ravitaillement préparées et planifiées sur des itinéraires toujours un peu semblables.
La logistique expéditionnaire demande des moyens de transport stratégiques et de calculer les besoins au plus juste, afin de ne pas saturer les lignes de communication. Lorsque vous avez le temps de planifier une opération, les règlements d’emploi imposent de projeter les moyens logistiques destinés à accueillir la force à l’arrivée du bateau ou de l’avion avec des rations et du carburant, avant de déployer les moyens de combat. Cette chronologie est idéale et nous la pratiquons depuis dix ans. Serval, par contraste, a été la mobilité par excellence : il fallait tirer profit d’un ennemi en fuite et les objectifs politiques se traduisaient par une tactique militaire consistant à saisir des points et instaurer des lignes symboliques sur le terrain le plus vite possible, d’où l’impossibilité de faire intervenir les moyens logistiques pour soutenir l’opération tant par manque de temps, que par manque de capacités de transport. Le rythme des opérations s’est avéré extrêmement soutenu : les premiers éléments sont arrivé sur le terrain le 10 janvier ; le 15 nous étions déjà à Markala et Douentza, où nous nous attendions à une confrontation avec l’ennemi : nous pensions rester un peu sur cette ligne et avoir le temps d’acheminer notre logistique, mais en fait, et heureusement pour nous, le 25 nous devions être à Gao et à Tombouctou, et, quelques jours plus tard, à Tessalit. Nous n’avons donc jamais eu le temps dans la projection de mettre en place tous les moyens dont nous avions besoin, mais le choix a été rapide : nous n’avons projeté que l’« extrêmement urgent » et ce dont les forces avaient besoin de manière vitale, à savoir les munitions, le carburant, des vivres, de l’eau et des moyens santé. Etant en phase d’intervention, nous avons abandonné tout le reste, c’est-à-dire toutes les fonctions logistiques s’inscrivant dans le cadre d’une opération de stabilisation – telles que la condition du personnel en opération, le soutien en aire de stationnement, l’hygiène, la sécurité et la prévention des accidents en opération -. Nous n’avons pas dérogé à la doctrine en satisfaisant les besoins urgents des forces et en les dimensionnant au plus juste, étant donnée l’absence de moyens de transport routier suffisants pour faire plus. Mais nous avons eu des frayeurs, car si nous faisions en sorte de viser une autonomie de trois jours, il nous est arrivé à deux ou trois reprises de nous retrouver dans certains secteurs à 24 heures de consommation : le casse-tête a consisté à continuer d’« alimenter la pompe », pour que nous ne descendions jamais en deçà des 24 heures, ce qui n’est pas énorme sur de telles distances. Ce fut le cas notamment en matière de carburant. Le Service des essences travaille en temps normal en opération avec une anticipation de stocks de l’ordre de la semaine : pendant trois semaines, nous avons été sur le fil du rasoir avec 24 heures…
La logistique militaire est, comme toutes les logistiques, confrontée à la logique de budget. Le concept de supply chain, basé sur des flux tendus, peut s’appliquer pour une entreprise civile en milieu stabilisé avec des modes de communication qui fonctionnent bien, mais pour nous, logisticiens militaires, le « zéro stock » équivaut à l’incapacité de mener une opération de type Serval. La difficulté consiste donc à trouver le juste équilibre entre un seuil de stocks minimum et un seuil suffisant pour alimenter la chaîne suffisamment longtemps pour que les stocks se reconstituent. Cette capacité à bien dimensionner les stocks dépend des contrats opérationnels qui nous sont passés à partir des éléments du Livre blanc, et bien sûr du budget : une fois que nous avons ces deux paramètres, nous sommes en mesure de travailler. La première question qu’un logisticien se pose concerne la taille de la force à soutenir : si vous ne connaissez ni le nombre d’hommes et de véhicules à projeter, ni le type d’opérations dans lesquelles ils sont engagés – maintien de la paix ou coercition -, vous ne pouvez pas faire de logistique, si ce n’est limitée au tout-venant, et, surtout, vous ne pouvez pas dimensionner les stocks. De façon générale, pour dimensionner correctement les stocks, on va raisonner en fonction des contingences les plus exigeantes, c’est à dire le combat de coercition : le contrat opérationnel fixé par le Livre blanc prévoit un certain nombre d’opérations de différentes natures, à mener en simultané ou en successif. Ce niveau d’activité opérationnelle va engager un nombre précis de moyens, de bateaux, d’avions de chasse, d’unités de l’armée de terre susceptibles de consommer dans une opération de guerre de haute intensité tant de munitions, etc… Sont alors déduits les stocks nécessaires et deux options sont offertes : soit ils sont constitués dès le départ, mais ces « stocks morts » reviennent cher en raison d’un entretien constant, soit vous faites le pari dangereux de constituer un stock partiel en fixant une capacité de reconstitution dans des délais précis avec un industriel, ce qui a également un coût qui va se répercuter, car ce dernier doit maintenir ses chaînes de montage. Le risque de rupture de stocks incite à rechercher d’autres solutions, telles que le recours aux stocks des alliés, qui avait été l’hypothèse envisagée pendant Harmattan au niveau des bombes. Pour Serval, le niveau requis de munitions a été calculé au plus juste pour du combat à haute intensité et pour faire face à un ennemi qui n’allait pas se laisser faire. Très rapidement, nous avons vu que l’ennemi fuyait le contact, et nous nous sommes demandé pendant une quinzaine de jours si nous n’avions pas envoyé trop de munitions. Mais dès lors que les combats dans l’Adrar ont commencé, il n’a fait aucun doute que nous en avions réellement besoin. En logistique militaire, de telles questions sont permanentes. Nous ne savons jamais à l’avance ce dont nous aurons besoin avec exactitude et nous ne pouvons pas vraiment anticiper. De ce fait, nous calculons et nous nous adaptons ensuite. En ce qui concerne Serval, les consommations ont en fait été classiques en quantité et en qualité face à un ennemi coriace, mais fuyant. Mais il faut bien avoir conscience du fait que dans le cas d’un conflit plus conventionnel, le remplacement ou le renouvellement des stocks serait problématique. Bâtir la logistique de production pour être capable de satisfaire la consommation requiert une planification d’autant plus complexe, que la sophistication croissante de certains matériels impose l’intégration de nouveaux paramètres.
Résoudre des problèmes d’acheminement particulièrement complexes
En arrivant au Mali, nous avons été immédiatement confrontés au simple problème d’acheminer les moyens avec nos gros porteurs. Le parking de l’aéroport de Bamako est capable d’accueillir simultanément cinq avions de type 747 ou Antonov, mais il ne peut faire le plein que de trois, et si vous faites le plein de trois gros porteurs pendant trois jours, vous asséchez l’aéroport. Or il nous est arrivé de mobiliser jusqu’à douze avions par jour. Nous avons donc trouvé deux solutions : nous avons fait en sorte d’une part que nos avions ne fassent pas tous le plein à Bamako, et d’autre part nous avons suppléé les citerniers locaux en acheminant notre carburant aérien à Dakar via dix citernes de 30 m3 du SEA transportées grâce au BPC (bâtiment de projection et de commandement) Dixmude. Ceci n’est pas une procédure normale, mais compte tenu de l’urgence, il a fallu s’adapter. Une des grandes difficultés de Serval fut l’acheminement de l’eau, qui a consommé énormément de moyens de transport. Au tout début de l’opération, nous avons cherché à éviter de faire venir de France des quantités massives de containers de bouteilles d’eau, afin de limiter la consommation en avions. Nous avons donc solutionné le problème en passant rapidement un contrat sur place et en externalisant la fourniture de bouteilles avec une livraison sur Gao. Au-delà de Gao, l’acheminement se faisait par moyens militaires. Au plus fort de Serval, nous avions au nord 2000 hommes consommant une moyenne de 10 litres d’eau par jour, ce qui représente quatre 4 containers 20 pieds/jour. L’acheminement de l’eau s’est donc avéré en soi une manœuvre à part entière assez complexe. Il faut ajouter à la problématique du volume une autre contrainte liée à la chaleur, à savoir la diminution de la capacité d’emport des avions, qui, aux heures les plus chaudes, descendait de 8 à 1 tonne. Il fallait assurer le transport de deux C130/jour sur Tessalit rien que pour l’approvisionnement en eau potable. L’armée de terre a amené sur le terrain, notamment à Gao, des Unités mobiles de traitement de l’eau (UMTA) : il s’agit de petites centrales de production d’eau tractables. Mais d’une part, la production est insuffisante pour satisfaire aux 10 litres/homme/jour et, d’autre part, cette eau est moins vouée à la consommation qu’à un usage sanitaire. Elle est potable, mais chimiquement pure, donc dénuée de sels minéraux (on ne peut pas faire de pain avec par exemple).
Les conditions d’une bonne génération de force et de son soutien. Un dispositif d’alerte réactif : le rôle de Guépard et des forces prépositionnées
Lors du lancement d’une opération, l’une des étapes concerne la génération de force. Vous recevez votre mission et vous étudiez les conditions dans lesquelles vous allez la remplir, la nature de l’ennemi, l’environnement géographique – y a-t-il des routes, des aéroports, des ports ? -, les conditions météorologiques – température, pluviosité -, etc… Une fois l’environnement déterminé, vous identifiez des modes d’action, puis les capacités dont vous avez besoin. Vous générez une force devant parfaitement correspondre à la mission sur le terrain. Pour Serval, la rapidité de décision a fait que l’on a utilisé notre dispositif d’alerte, à savoir le système Guépard, qui nous a permis de réagir extrêmement rapidement. Le Guépard est une boite à outils élaborée pour réagir au plus vite dans le cadre de missions qui ne sont bien évidemment pas prédéfinies. En utilisant le Guépard, vous allez bénéficier rapidement de moyens, mais de moyens créés de manière générique, et qui ne sont donc pas forcément adaptés au millimètre près à la mission que vous allez remplir. D’où certains écarts que l’on s’emploie et que l’on s’est employé à corriger en projetant des moyens supplémentaires en fonction de ce que nous demandait le théâtre d’opération. Il est normal que le Guépard ne soit pas complètement taillé pour chaque mission : c’est du prêt à porter, et il y a des retouches à faire, mais au moins vous êtes habillés pour sortir ! Parmi ces retouches, la question des chaussures est symptomatique : le problème de la Rangers est connu depuis longtemps, en ce sens que nous avons des semelles thermosoudées qui conviennent pour les opérations menées dans des températures normales. Si on dépasse la température maximale, il n y a pas de garantie du constructeur. Au-delà d’une certaine température, la semelle se décolle et c’est pour cette raison que l’Armée de terre demande des chaussures particulières pour zone chaude, ce qui a été fait pour l’Afghanistan même s’il a fallu changer de modèle en un deuxième temps. Pour le Mali, les personnels militaires Guépard sont donc partis avec les équipements génériques toute saison qu’ils avaient, mais il faut noter qu’il ne s’est pas passé plus d’une semaine entre le moment où le problème a été constaté et celui où les chaussures sont arrivées sur le théâtre d’opération. Nous avons joué de malchance, car le Commissariat qui a réagi très vite avait conditionné les Rangers dans des containers, mais l’avion qui devait les emporter est tombé en panne et il a fallu tout repalétiser pour qu’un autre aéronef les emmène. Cela nous a pris 48 heures de plus et, vues les conditions, une semaine cela peut être long, mais ce sont les aléas : c’est le brouillard de la guerre… Ce dont il faut avoir conscience est que l’on ne peut pas avoir un équipement tout théâtre qui convienne à toutes les saisons et la chaussure polyvalente n’existe pas. Il faudrait avoir dans son sac toutes les options, ce qui pose d’autres problèmes en termes d’acheminement et revient cher, d’où la nécessité de faire un compromis.
Guépard nous a permis de « mettre le verre d’eau » avant de pouvoir envoyer le camion de pompier. De même, les forces prépositionnées nous ont aidés à réagir très rapidement, y compris sur le plan logistique. Les forces prépositionnées sont des modules opérationnels et la logistique y est associée : nous avons donc puisé simultanément au Tchad et en Côte d’Ivoire et prélevé sur ces deux théâtres d’opération des munitions, du carburant et des vivres. Les forces prépositionnées ont donc surtout joué un rôle majeur au niveau des premiers modules de forces, ce que l’on appelle l’autonomie initiale. Avoir des éléments français au Sénégal a par ailleurs aidé à passer différents contrats tout de suite à Dakar et à accueillir les bateaux. Nous avons gagné en souplesse et évité d’avoir à déployer le personnel militaire, dont c’est le métier, tel que le 519 RT, une trentaine de militaires du Groupement de transbordement maritime dédié au chargement et déchargement des navires. La combinaison du guépard et des forces prépositionnées a donc bien fonctionné pour parer au plus pressé. En ce qui concerne les munitions, nous avons étroitement travaillé avec le Service interarmées des munitions (SIMu), qui était encore embryonnaire lors d’Harmattan et qui a parfaitement réagi. Tellement bien que le premier soir du déclanchement des opérations, dans la nuit du 10 au 11 janvier –, le SIMu a été, à notre demande, capable de doubler les quantités de munitions normalement requises en alerte, à savoir trois jours de combat. Nous savions que nous aurions des problèmes d’élongation et avions décidé de doubler le nombre d’unités de feu. Le CMT et le CCTS ont également été en mesure de doubler les moyens de transport nécessaires pour leur acheminement. Il se trouve que par hasard la brigade logistique de Montlhéry avait armé un petit centre d’opération pour un exercice, ce qui a permis de mettre rapidement en alerte des camions supplémentaires. De même, le CCTS a fait un travail remarquable avec la SNCF pour mettre sur pied des convois ferrés en un temps record. Il existe un petit organisme, le commissariat général au transport (CommiJ3), lequel est positionné auprès du ministère des transports, afin de faire le lien en cas de crise avec la SNCF et les transports maritimes pour obtenir des vecteurs, mais aussi pour obtenir des créneaux sur les autoroutes, et cette planification a parfaitement fonctionné.
Une chaîne logistique globale cohérente
Sur le plan de l’exécution, Serval a démontré par ailleurs que, même si la dernière décennie a donné lieu à une logistique relativement stable, nous disposons encore des moyens et des savoir faire nécessaires pour mettre en œuvre une logistique extrêmement mobile, capable de s’adapter, de réagir et in fine de soutenir une opération quelle que soit la cadence. Ce qui est rassurant est d’avoir pu entretenir la culture et la capacité de travail pour imaginer et adapter la ressource, le matériel et les équipements requis pour faire face aux contraintes de la logistique d’urgence. Le fait par exemple de pouvoir compter sur des stocks importants de rations, alors que nous aurions pu nous dire que ce n’était plus la peine en raison du type d’opérations de stabilisation habituellement menées, s’est avéré crucial, car nous en avons consommé bien plus que prévu. Avec des températures de 55 degrés à l’extérieur, donc plus de 70 degrés dans les containers, il a fallu faire tourner les stocks, une boite de rations étant garantie jusqu’à 55 degrés. Le seul avantage est qu’elles étaient consommables tout de suite, car à température ! Les plans d’entretien des armées françaises s’adaptent et réagissent, car la logistique de production suit grâce à des clauses contractuelles permettant de répondre à la demande. Si notre système logistique n’avait pas cette souplesse et cette réactivité non seulement sur le terrain, mais aussi en métropole, nous ne pourrions pas conduire des opérations de ce type. Au-delà de l’action menée sur le terrain, c’est toute la chaîne logistique des armées qui démontre sa capacité d’absorption. La Sous-chefferie Soutien de l’EMA doit faire en sorte que les contrats passés avec les entreprises permettent cette réactivité et cette souplesse. Et c’est bien là l’enjeu de l’avenir, car une entreprise doit être à même de maintenir des capacités de production sur ses chaînes, des compétences, des stocks, et cela lui coûte cher. Et si cela coûte cher à l’entreprise, cela coûte cher aux armées aussi par ricochet. L’un des enjeux des coupes budgétaires ne concerne pas seulement les matériels, mais la capacité à les soutenir via un système logistique global et des contrats de production suffisamment réactifs pour pouvoir continuer ainsi.
Des connaissances acquises et un aguerrissement adaptés
Nos militaires ont été bien entraînés pour faire face aux menaces caractéristiques du terrain malien (embuscades ; attaques suicides ; IED). Même s’il existe une différence en termes de niveau et de probabilité d’engagement entre armes de mêlée et soutien, il est classique de vouloir affaiblir la logistique de l’adversaire : on ne va pas toujours frapper sur les forces les plus dures où on sait que l’on va se confronter à des combattants aguerris. Ce principe de guerre existe depuis des lustres et la logistique de convoi est une proie de choix, car il est très difficile de sortir d’une embuscade, seul avec des équipements qui ne sont pas des équipements de combat. Il faut donc se préparer aux menaces qui nous sont propres. Pour ce faire, le blindage des véhicules a été renforcé et la préparation militaire intensifiée. La mise en condition avant projection (MCP) est adaptée au terrain, mais est la même que pour l’Afghanistan en termes de vigilance, savoir faire et réactivité. La plupart des logisticiens qui sont partis pour Serval ont fait l’Afghanistan et possèdent une bonne connaissance des tactiques à mettre en œuvre et des réactions à avoir. Etant donné le peu d’unités logistiques et le nombre de théâtres d’opération, les gens tournent beaucoup et les chefs de corps des RT ont tous maintenant une dizaine d’opérations extérieures à leur actif, ce qui est assez extraordinaire. La difficulté en logistique n’est pas tant un volume de forces donné sur un théâtre d’opération, mais le nombre de ces théâtres. On a des effets de seuil, en ce sens que, que l’on soit 10, 50 ou 1000, il faudra toujours un nombre minimal de logisticiens en dessous duquel vous ne pourrez pas descendre. On considère qu’il y a environ 30 % de logisticiens pour une force en France, les 70% restant incluant les armes de mêlées, le commandement, les transmissions, les appuis. Cela se vérifie sur tous les théâtres d’opérations. Au Mali, on est légèrement en-dessous, ce qui pour des élongations pareilles est un peu problématique.
Serval, côté soutien, a donc été possible, parce que nous avons une chaîne logistique cohérente qui inclut les stocks des entreprises françaises qui travaillent avec nous. Ceci, couplé à la préparation opérationnelle, à l’entraînement, à vingt ans de carrière en moyenne de jungle, désert et montagne, permettent ce résultat. Le défi est donc de faire en sorte de conserver un outil logistique et un entraînement qui génèrent cette souplesse et cette réactivité et entretiennent cette culture et faculté d’adaptation. C’est ce qui est le plus important, car un équipement magnifique mal servi est inutile. C’est cette chaîne générale qui va de l’entreprise et des Etats-majors aux opérationnels de terrain qui doit être cohérente. Si un maillon de cette chaîne est cassé, on n’arrivera plus à reproduire ce type d’opérations. L’ambition est d’être capable de maintenir ce savoir faire. On s’est rendu compte au Mali que l’on ne pouvait mener une opération que si on était capable de la soutenir avec deux critères essentiels : le soutien carburant, car sans carburant on ne peut pas avancer, et le soutien santé sur lequel aucune impasse n’a été faite. Avec Serval, le caractère dimensionnant de la logistique a été redécouvert…
Le Colonel Guéguin fait partie de cette génération de logisticiens partis régulièrement en OPEX – dans son cas, la Bosnie et le Kosovo – et qui a assisté à la transformation de la « logistique de Corps d’armée » propre à la Guerre froide vers une « logistique expéditionnaire » inaugurée en premier lieu par les Britanniques lors de la guerre des Malouines en 1982. Au moment de cet entretien réalisé pendant Serval, environ 30% des unités logistiques étaient déployées entre l’Afghanistan, le Liban et le Mali : des rotations en OPEX donc particulièrement soutenues, toute force déployée nécessitant un soutien logistique représentant systématiquement et quelle que soit la nature de l’opération 30% du volume de forces engagé. Dans le cas de Serval, opération logistique par excellence, ce ratio était pourtant moindre en raison de la rapidité d’action requise. Le Colonel Guéguin, en charge d’organiser en amont le soutien logistique de cette opération hors du commun, explique les difficultés rencontrées, mais aussi les facteurs de réussite pour mener à bien cette mission unique. Il souligne l’importance de ne pas baisser la garde, afin de préserver les savoir faire et l’adaptabilité de toute la chaîne logistique – depuis l’entreprise jusqu’au combattant -, pour contribuer à la victoire malgré le «brouillard de la guerre ».