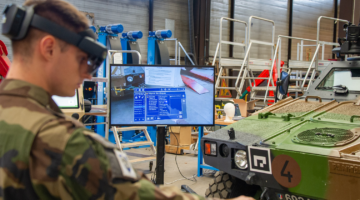Entretien avec le Général de brigade aérienne Philippe Montocchio, COMFOR FFDj / propos recueillis par M. Delaporte
Le Général de brigade aérienne Philippe Montocchio a pris le commandement des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) le 9 août 2014. Pilote au sein de l’Escadron de chasse (EC) 03.002 « Alsace », il fut tour à tour instructeur sur F-16 à Luke Air Force Base en Arizona, Chef des opérations de l’EC 01.012 « Cambrésis », et officier responsable du suivi opérationnel du Mirage 2000 C à l’Etat-major de la Force aérienne de combat à Metz. Elève du Collège interarmées de défense en 1996, il fut ensuite Commandant de l’EC 02.005 « Ile de France », puis attaché de défense en Grèce. Après plusieurs années à la Délégation aux affaires stratégiques, il occupa différentes fonctions au sein du Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) entre 2009 et 2014 (à l’exception de 2011, année pendant laquelle il fut Inspecteur emploi de l’armée de l’Air). Avant de rejoindre Djibouti, son dernier poste à Lyon était celui de Chef d’état-major du CDAOA.
Dans l’entretien ci-dessous, le Général Montocchio explique les missions – d’entraînement, de soutien logistique et de renfort – qui l’attendent dans une région marquée par l’instabilité politique et la présence d’Al-Qaïda, ainsi que la place des forces françaises de présence stationnées à Djibouti dans un contexte de coopération à la fois bilatéral et multilatéral en pleine évolution. Pour le COMFOR FFDj, Djibouti constitue l’« anti-chambre des opérations » à plusieurs titres :
- comme théâtre d’entraînement exceptionnel pour les missions assignées aux forces armées françaises au cours de ces dernières décennies de l’Afghanistan à la Bande sahélo-saharienne ;
- comme capacité de soutien logistique aux implantations (en particulier aux Emirats arabes unis) et opérations extérieures de proximité, mais parfois hors de sa zone de responsabilité permanente comme ce fut le cas pendant Sangaris ;
- comme force d’appui et d’appoint pour ces dernières.
Lorsque l’on se penche sur l’histoire de Djibouti, ce pays semble aujourd’hui à la croisée des chemins tant au niveau de sa fonction stratégique que de sa politique de coopération militaire, laquelle se multilatéralise chaque jour un peu plus. En tant que Commandant des Forces Françaises de Djibouti (FFDj), comment percevez-vous l’évolution stratégique de ce pays indépendant depuis 1977 ?
Djibouti a toujours été un endroit stratégique. Il suffit de regarder une carte pour se rendre compte que ce territoire se situe au cœur d’une route d’approvisionnement cruciale pour l’Europe, mais aussi pour nombre de pays alliés, tels que le Japon et les Etats-Unis par exemple.
- La présence des Japonais sur cette implantation, laquelle constitue leur seule base à l’étranger, fut initialement motivée par la lutte contre la piraterie. Elle va se pérenniser, car les Japonais ont parfaitement identifié le positionnement stratégique de Djibouti.
- Les Américains ont fait le même constat depuis le début des années 2000, lorsque le « United States European Command », US EUCOM, s’est scindé en deux en donnant naissance à US AFRICOM. L’Etat djiboutien a ouvert ses portes à un moment où les mentalités n’étaient pas prêtes à ce que les Etats-Unis s’installent sur le continent africain. Même si Djibouti n’est pas le seul foyer d’instabilité sur ce dernier, il se situe au cœur d’un arc de crises incluant le Yémen, le Darfour, le Sud Soudan ou encore la Somalie, autant de zones de crise à la périphérie de Djibouti.
Quelle est la raison d’être des FFDj et quel rôle jouent-elles en termes de soutien aux opérations extérieures et de projection de forces ?
Pour nous Français, Djibouti a toujours joué un rôle de point d’appui à la fois Marine et Air. Si l’on fait un rappel sur l’origine de notre présence ici, celle-ci est tout d’abord, et en premier lieu, motivée par le traité de défense qui nous lie à l’état djiboutien. Il s’agit là de la raison première d’une présence militaire française à Djibouti. Ensuite, Djibouti constitue effectivement un point d’appui assez extraordinaire à la fois maritime, aéronautique, voire terrestre si une crise intervenait non loin d’ici sur le continent. Djibouti offre par ailleurs un vaste camp d’entraînement que l’on ne retrouve pratiquement nulle part ailleurs, et certainement pas en métropole. S’il existe des possibilités géographiques à peu près analogues aux Emirats Arabes Unis, qui accueille notre base la plus récemment implantée hors du territoire français, nous ne disposons pas de la même liberté d’entraînement qu’à Djibouti, et ce, en ce qui concerne toutes les composantes : Terre, Air, Mer et Forces spéciales. En raison de cet environnement extraordinaire pour l’entraînement, Djibouti est aujourd’hui pour nous l’antichambre des opérations. Ce fut le cas en ce qui concerne les opérations en Afghanistan pendant toute la durée de notre implication là-bas, et c’est le cas aujourd’hui en ce qui concerne les opérations menées au Sahel. En dehors de son aspect marin, Djibouti présente en effet, en ce qui concerne l’aspect terrestre, exactement le même environnement, aussi rude et aussi difficile que celui qui règne au Sahel et que celui ayant présidé aux opérations menées au Mali pendant Serval.
Si je reviens sur votre question, Djibouti a donc toujours été effectivement un nœud logistique et un point d’appui extrêmement important pour nos projections vers l’Afrique et en soutien de nos forces implantées dans la zone Sud de l’Océan Indien, à savoir les FAZSOI (forces armées dans la zone du sud de l’Océan indien). Djibouti constitue aussi une base de soutien « en deuxième rideau » des implantations que nous avons aux Emirats Arabes Unis (EAU). Nous avons un lien très fort avec ces dernières, tant comme force d’appoint que comme soutien logistique. Nous assumons les deux missions. De fait, tous les soutiens dont nous disposons à Djibouti – qu’il s’agisse du soutien de l’homme, du soutien infrastructure ou encore du soutien médical – couvrent également nos forces déployées aux EAU.
Mon commandement inclut donc du personnel sous gestion FFDj, mais qui se trouve positionné de façon permanente aux EAU, pour conseiller mon homologue au FFEAU notamment dans le domaine « infra » et dans le domaine médical et assurer un suivi sur place dans ces deux domaines. Le lien entre les deux bases FFDj et FFEAU est donc très fort.
Cette projection est-elle prédéfinie ou dépend-elle de l’évolution du contrat opérationnel et des missions ? Le soutien des FFDJ aux opérations, comme ce fut le cas pour Serval et Sangaris, repose-t-il sur le même principe ?
L’ordre de grandeur s’évalue à quelques officiers en place au profit des FFEAU, mais qui sont en lien avec leur base mère ici à Djibouti. Il n’existe pas de contrat définissant le nombre de forces ou de moyens à projeter aux EAU, d’autant qu’une telle projection s’effectue en fonction de – et est dictée par – l’émergence d’une crise ou d’un problème à résoudre. Elle peut concerner les EAU, mais aussi La Réunion où sont basées les FAZSOI.
Les différentes missions des FFDJ sont donc d’abord d’honorer le traité de coopération de défense, puis de fournir des capacités d’entraînement pour un grand nombre d’unités tournantes en provenance de métropole, mais aussi d’être ainsi un réservoir de forces, prêt à être employé principalement dans la région en fonction des circonstances. Il s’agit là d’une mission importante et assez dimensionnante. En ce qui concerne la République centrafricaine et l’opération Sangaris, celles-ci s’inscrivent en dehors de ce qu’on appelle la zone de responsabilité permanente ou ZRP des FFDj.
Chaque base militaire française implantée en Afrique, dans l’Océan Indien et aux EAU est commandée par un officier général (que l’on appelle soit un COMANFOR, soit un COMSUP, soit un COMFOR comme ici à Djibouti) auquel est confiée une zone de responsabilité essentiellement tournée vers la protection des intérêts français dans un périmètre plus global recouvrant à peu près celui couvert par les organisations régionales en Afrique. La RCA relève de la zone de responsabilité des Forces françaises stationnées au Gabon, et non des FFDj, mais dans la mesure où il s’agit d’une opération extérieure, les forces qui sont à Djibouti sont tout aussi éligibles que celles qui sont en métropole pour effectuer une relève. C’est ce qui s’est passé au printemps 2014, lorsqu’une partie des éléments du 5ème Régiment interarmées d’Outre-Mer (5e RIAOM) implanté à Djibouti est allée s’insérer dans le dispositif Sangaris de façon plus globale. Il s’agissait essentiellement de troupes de mêlée, donc essentiellement de l’infanterie, la plupart des appuis venant d’autres unités métropolitaines et étant donc déjà fournis sur place par Sangaris. Du matériel, des véhicules et des hélicoptères venant de Djibouti ont également été mis en place à N’Djamena au profit de cette même opération. En ce qui concerne Serval, aucun détachement FFDj en tant que tel n’est parti et nous n’avons pas été identifiés pour participer à l’opération Barkhane.
En revanche, si Chammal devait s’inscrire dans la durée et même si Djibouti est éloigné du théâtre irakien, nous sommes véritablement en deuxième rideau par rapport au Moyen-Orient et nous entrons dans le même type d’équation que pour la RCA. Au même titre que le 5ème RIAOM a été engagé pour Sangaris, des éléments FFDj – notamment des moyens aériens – peuvent très bien être engagés si nécessaire à un moment ou à un autre pendant la relève d’unités venant de métropole. Nous faisons intégralement partie de l’ensemble du réservoir de forces dont dispose le Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) pour les utiliser dans des crises régionales.
Avec la présence plus marquée des Etats-Unis à Djibouti, la coopération franco-américaine dans la région s’est-elle renforcée au fil des années ?
Notre coopération avec les Américains est très forte et s’avère essentiellement centrée autour de la gestion de la crise somalienne. Si les américains sont très impliqués dans cette gestion de crise, leur implantation à Camp Lemonnier continue à grossir et est devenue un « hub » très important pour travailler sur l’ensemble de la région.
Les Américains s’efforcent de coordonner l’action des différents pays africains qui sont engagés dans l’AMISOM « African Union Mission to Somalia », à savoir la mission africaine engagée en Somalie. Nous nous inscrivons dans ce sillage en complémentarité avec les forces américaines. Ainsi, par exemple, il existe en Ouganda un camp d’entraînement, de formation et de préparation des forces armées du pays destinées à partir en opération de maintien de la paix ou de stabilisation, suivant un programme mis en place par les Etats-Unis en 2006. Ce programme s’appelle ACOTA pour « African Contingency Operations Training and Assistance » et assure une préparation d’une durée de deux mois au profit d’un bataillon ougandais. Quatre nations participent à ce programme de formation : en plus des Américains (essentiellement des Marines et des « contractors ») et des Français, les Britanniques sont également présents, et, à moindre échelle, les Néerlandais qui fournissent de temps en temps des instructeurs. Nous en sommes aujourd’hui au quinzième Groupement tactique ougandais formé depuis 2006 principalement par les Américains, mais avec un appui apprécié des Britanniques et des Français, ce qui représente sur huit ans environ 25 000 soldats ougandais passés par ce centre de formation et de préparation avant leur projection en Somalie. Les Américains apprécient notre habitude de travailler avec les Africains et notre savoir-faire opérationnel en Afrique.
En termes de répartition des missions de formation, il existe, dans le cadre d’ACOTA, plusieurs segments :
- un segment de base qui constitue la formation individuelle : c’est celui dont nous nous chargeons, étant les mieux équipés pour le faire. L’Ouganda n’est pas notre zone d’influence historique, mais nous arrivons à nous adapter en utilisant le français, l’anglais, le swahéli, ou ce que l’un de nos commandants de détachement appelle le « Swanglais » (mélange de Swahéli et d’anglais). Deux fois par an, en fonction des calendriers des Américains et des Français, nous envoyons ainsi une trentaine d’instructeurs pendant un mois et prenons à notre charge toute la formation individuelle de base.
- Nous travaillons également sur la formation des postes de commandement, à l’échelon supérieur, les Britanniques étant en charge l’exercice de synthèse lors de la dernière semaine clôturant ces deux mois de formation. Nous allons intégrer deux ou trois instructeurs dans cette partie formation PC, ainsi qu’un observateur dans l’exercice de synthèse afin d’évaluer comment nous y inscrire et y participer avec les Britanniques.
Les Américains assurent la formation, mais aussi la logistique et le transport du Groupement tactique en Somalie.
En ce qui concerne la crise somalienne, nous coopérons donc au sein d’un programme et dans un cadre fixés par les Américains, mais aussi en bilatéral avec des partenaires africains. Nous avons ainsi travaillé avec les Burundais selon le même format qu’avec les Américains, mais en bilatéral et en dehors du programme ACOTA. Nous formons des contingents burundais, mais aussi djiboutiens, avant qu’ils ne soient déployés en Somalie. Enfin, nous aidons également à la résolution de la crise au travers de notre participation financière dans les différentes missions de l’Union Européenne. Un soutien financier n’est pas aussi visible que l’envoi de soldats pour aller faire de la formation, mais ce qu’il faut savoir est qu’un soldat sur cinq de l’AMISOM – qui compte 22 000 soldats – est payé par la contribution française au budget de l’Union Européenne.
Djibouti accueillant de plus en plus de forces armées étrangères, comment s’articulent les différents cadres d’action et de coopération internationale ?
Il n’existe ni cadre européen, ni onusien. La France n’envoie pas d’instructeurs dans la mission de training européenne, l’EUTM (« European Union training Mission »), mais la finance en tant qu’état membre de l’Union européenne. En plus de l’AMISOM, la France finance aussi les deux autres missions les plus visibles sur la Somalie, à savoir d’une part, la mission EUCAP Nestor1 essentiellement tournée vers la mise en place d’un système juridique et la formation de garde-côtes en Somalie, et d’autre part, la mission ATALANTE2 de lutte contre la piraterie, dont le mandat est maintenant élargi à la sécurité de l’ensemble du trafic maritime. En ce qui concerne ATALANTE, la France participe également avec des moyens militaires – navires et avions de patrouille maritime -. Nous avons ainsi accueilli en octobre dernier un Falcon 50 de la Marine nationale, venu faire une période de deux semaines dédié à l’opération ATALANTE en restant basé à Djibouti.
Mais c’est dans le domaine logistique que notre soutien à l’ensemble des pays alliés présents dans la région est peut-être le plus marqué. Nous assurons ce soutien sans distinction d’appartenance à l’OTAN ou l’UE, voire aux pays alliés asiatiques. Grâce à nos installations en matière de soutien santé, nous soutenons ainsi au niveau médical les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Japonais, etc… Nous avons accueilli ces dernières semaines à l’hôpital Bouffard un marin italien déployé pour ATALANTE, puis un marin sud-coréen. Nous servons par ailleurs de facto de base logistique pour les Espagnols et les Allemands, lesquels déploient un petit détachement d’avions de patrouille maritime au profit d’ATALANTE ou de l’opération « Ocean Shield » menée sous le commandement de MARCOM (« NATO Allied Maritime Command »). Ces pays n’ont ni base en Afrique, ni les moyens d’en projeter une rapidement, aussi bénéficient-ils des installations dont nous disposons sur la BA188. Ils ont ainsi installé au sein de cette dernière, à moindre coût aussi bien financier et logistique qu’humain, un petit « Spanish corner » et un petit « German corner ». En plus des Américains, Allemands, Espagnols, Japonais, on trouve aussi à Djbouti des militaires Italiens et un petit détachement suédois.
Par rapport à toutes ces nations présentes sur le territoire djiboutien, la France a un positionnement un peu différent : nos forces sont stationnées en permanence et les militaires en séjour de courte ou longue durée y viennent pour s’entraîner. Lorsque les forces de présence françaises ne sont pas utilisées en opération, elles font de fait essentiellement de l’entraînement pour être prêtes à intervenir en cas de besoin. A l’inverse, toutes les forces étrangères implantées à Djibouti ne sont venues ici que dans le cadre d’une opération, qu’il s’agisse des Américains, des Espagnols ou des Allemands. Les Italiens ont maintenant des capacités commençant à être stationnées de façon permanente sur Djibouti et sont donc un peu plus sur le même portage que nous, mais les forces étrangères impliquées dans les opérations ont forcément beaucoup moins de temps à consacrer à l’entraînement. Mais dès qu’une opportunité d’entraînement commune se présente, nous n’hésitons pas.
Comment voyez-vous l’évolution de notre présence à Djibouti et quels sont les axes de développement que vous souhaitez mettre en œuvre pendant votre commandement ? Notre implantation pourrait-elle faire office de Centre d’excellence en matière d’entraînement par exemple ? Quelles sont, à l’inverse, les difficultés que vous rencontrez au quotidien ?
Djibouti joue déjà de facto, et de façon implicite, ce rôle de centre d’excellence au niveau de la formation. Nous partageons en effet les champs de tir et les camps d’entraînement que nous utilisons ici avec d’autres nations, comme les Etats-Unis et l’Italie. Nous avons à titre d’exemple organisé en octobre une compétition de tireurs d’élite des Forces spéciales à laquelle ont participé les Américains, les Italiens et les Français (dont le GIGN). Djibouti est vraiment une terre de prédilection pour faire de l’entraînement interarmées de haut niveau en milieu désertique et dans un cadre très réaliste. En dehors des Japonais et des Espagnols, dont les capacités déployées ici se limitent surtout à de la patrouille maritime et qui sont en opération en permanence dans le Golfe d’Aden et dans l’Océan Indien, nous bénéficions donc d’opportunités d’entraînement commun avec les Américains, les Italiens ou encore les Allemands.
En termes d’évolution, les axes sont relativement intangibles, car les FFDj s’inscrivent dans un panorama qui ne date pas d’aujourd’hui. Dans la zone de responsabilité qui m’incombe, se trouvent le Yémen, la Somalie et le Sud Soudan : trois pays en crise depuis des années, voire des décennies. En ce sens, mes contrats, mes objectifs et mes missions ne seront pas foncièrement différentes de ceux de mes prédécesseurs. A Djibouti, nous nous trouvons face à de grandes constantes stratégiques : assurer la liberté des approvisionnements, œuvrer à la stabilité de la corne de l’Afrique, contribuer en bilatéral ou en interallié à la gestion des crises qui agitent cette partie du monde (Yémen, Somalie), utiliser Djibouti comme un centre unique d’entraînement, de formation et d’aguerrissement. Il s’agit là des grandes tendances lourdes qui sous-tendent notre présence à Djibouti et qui, à mon sens, ne devraient franchement pas évoluer dans les deux ans qui viennent.
La coopération avec Djibouti est bien-sûr notre fil rouge : il s’agit là d’une constante issue du traité conclu au lendemain de son indépendance et des relations nouées au fil du temps.
Parmi les évolutions, il faut également tenir compte de la réduction du format des FFDJ, laquelle répond aux grandes orientations décidées par le Président concernant les forces armées françaises. Ce mouvement d’ensemble touche aussi bien les formations, les unités et les armées basées en métropole, que celles qui sont basées à l’étranger ou dans les territoires d’Outre-Mer. Nous allons donc devoir adapter notre mode de fonctionnement, puisque Djibouti comptait encore 3 000 hommes en 2011, 2 000 aujourd’hui avec le départ de la 13e DBLE (Demi-Brigade de la Légion étrangère). Les FFDj ont donc déjà dû absorber une réduction d’un tiers de leurs effectifs et vont continuer à décroître avec le départ de quelques centaines de personnels dans les deux ans qui viennent. Notre format final devrait a priori nous permettre de continuer à mener de front à peu près toutes nos grandes missions, mais, pour reprendre l’expression du Chef d’état-major des armées, nous le ferons « ensemble, autrement et au mieux ». Nous allons devoir adapter nos missions de présence en fonction du format dont nous disposerons en termes de matériel et nombre de personnels. Nous serons peut-être contraints de réduire en temps et en fréquence les missions de coopération et de formation que nous faisons au profit de Djiboutiens ou des Burundais par exemple, de la même façon que le départ de la DBLE en 2011 – dont le choc culturel et opérationnel est maintenant absorbé – n’a pas fondamentalement ni modifié les missions, ni contraint à l’abandon d’une partie d’entre elles, mais a malgré tout réduit le champ des possibles.
L’introduction de nouvelles technologies ou de matériels plus modernes (dans le domaine des radars par exemple) peut-elle compenser en partie cette déflation des effectifs ?
Certainement, mais nous ne pourrons en mesurer l’impact que dans les années futures. A court terme, nous allons également réduire notre empreinte logistique et notre emprise, car nous n’avons plus besoin de conserver toute la surface habitable et le parc immobilier dont nous disposons aujourd’hui. La tendance vers un resserrement du dispositif sur la ville de Djibouti fut amorcée avec le départ de la 13e DBLE, puisque les installations des unités de la Légion un peu satellites, qui étaient stationnées à cinquante kilomètres d’ici près du village d’Arta, ont été rétrocédées à l’état djiboutien. Ce changement d’organisation ne nous empêche pas de continuer à aller au contact de la population et de faire des patrouilles combinées avec les forces djiboutiennes dans le pays, notamment le long de la frontière avec le Somaliland, où l’immigration clandestine et les trafics qui existent dans cette région sont une préoccupation constante pour les Djiboutiens. Nous menons ces missions à partir de la ville de Djibouti et non à partir d’unités implantées sur le territoire djiboutien : nous le faisons « autrement »…
Comment décririez-vous vos premiers mois de mission en tant que COMFOR FFDj ?
Etant donné le contexte géostratégique de la région et le cadre des missions qui nous sont confiées ici, disposer de moyens diversifiés constitue un atout phénoménal. L’emplacement en lui-même est très important sur le plan stratégique et très intéressant en matière de préparation opérationnelle et d’aguerrissement, tandis que les capacités dont nous disposons s’avèrent assez uniques. Si les FFEAU bénéficient de la même diversité et de matériel certainement plus récent, le format est plus réduit.
Pour agir dans toute la sous-région, nous disposons en effet de forces aériennes, de forces terrestres – lesquelles ont encore récemment démontré leur utilité dans le cadre de leur mandat dans l’opération Sangaris -, et de forces navales. Cette composante navale est essentiellement tournée vers le soutien, les capacités navales étant ici très limitées et locales. En revanche, le port et l’accès privilégiés que nous avons créés à Djibouti sont particulièrement appréciables et capables d’accueillir les forces françaises, qu’il s’agisse du porte-avions Charles De Gaulle et de son groupe 3ou d’équipes de forces spéciales.
Aussi importantes que les forces aériennes, terrestres, navales et spéciales, il ne faut pas oublier ce que je considère comme la « cinquième composante opérationnelle », à savoir le corps médical. Ces opérationnels travaillent parfois dans l’urgence au tempo des missions. Ils accompagnent notamment les détachements de l’instruction opérationnelle en Ouganda, en assurant les premiers secours, mais aussi l’instruction opérationnelle d’urgence. La composante santé constitue ainsi traditionnellement un vecteur d’influence et de coopération très intéressant au regard du soutien que nous apportons aux hautes autorités et aux forces armées djiboutiennes, ainsi qu’à l’ensemble des alliés basés ou en transit à Djibouti.
Ce qui est fascinant et particulièrement motivant à Djibouti est ainsi la chance de disposer d’un condensé des forces armées françaises, puisque, pour garder la cohérence de cet outil, toutes les composantes y sont représentées. Cette complémentarité unique et la diversité des forces de présence sont vouées à perdurer malgré les restructurations en cours.