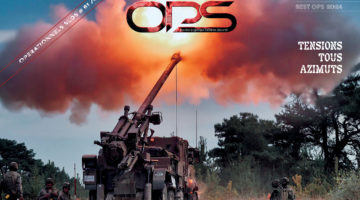Un MCO tiré par l’activité
Le MCO, un facteur dimensionnant pour les formats de l’armée de l’air
Lorsque l’on évoque le MCO, le problème est de savoir quelle vision on en a et d’identifier la part des ressources qu’il convient d’y consacrer. Ce n’est pas tant une question d’impact de réductions budgétaires, car même en augmentant le budget alloué, une question demeurerait : quelles sont les priorité ? Le contexte dont il faut à mon sens tenir compte pour apporter un début de réponse est double :
– Premier point primordial à mes yeux : d’une façon générale et en particulier pour l’aéronautique, le MCO a aujourd’hui pris un tel poids (financier, mais pas seulement), qu’il est en fin de compte un facteur dimensionnant pour nos formats, dans la mesure où ce il ne sert à rien d’avoir une multiplication de matériels si on ne se donne pas les moyens d’en l’activité. Ce sujet est important et a été à mon avis trop longtemps négligé, en ce sens que l’on a eu tendance à se concentrer sur l’achat des équipements et des matériels en passant beaucoup trop vite sur le MCO. Preuve en est la quasi-absence d’études technico-opérationnelles ou d’études amont sur ce thème, ce qui est pour moi une véritable erreur, car il s’agit d’un vrai sujet aujourd’hui sur lequel on devrait faire des efforts, y compris dans la recherche de solutions innovantes.
– Deuxième point : le MCO pour nous, ce n’est pas de la disponibilité, mais de l’activité. Contrairement aux compagnies aériennes, il ne s’agit pas d’une activité régulière requérant une disponibilité extrêmement forte. C’est une activité qui dépend principalement de nos missions opérationnelles et de notre entraînement. La bonne disponibilité se situe au niveau maximum quand on en a besoin et au niveau minimum quand on n’en a pas besoin. De fait, si on a une très bonne disponibilité quand on en n’a pas besoin, c’est que l’on a dépensé de l’argent et utilisé du personnel pour rien. C’est donc beaucoup plus compliqué au bout du compte, dans la mesure où notre activité n’est pas linéaire, sauf en ce qui concerne les formations en école, où des processus d’externalisation ont pu être mis en place et fonctionnent bien comme c’est le cas à Cognac. En revanche, notre activité de combat, laquelle implique tous nos matériels – chasse, transport, hélicoptère, systèmes d’information – est en sinusoïde avec des creux et des pics auxquels la disponibilité doit pouvoir s’adapter. Et pour compléter, nos deux missions permanentes essentielles que sont la protection et la dissuasion exigent, elles, une disponibilité continue des moyens d’engagement des forces et de surveillance du territoire.
L’opérationnel au cœur de l’expression de besoin
Il est par ailleurs fondamental pour notre organisation que l’opérationnel soit au centre de l’expression du besoin. Cette expression de besoin et les marchés que l’on passe sur le MCO doivent être tirés par la façon dont on utilise les matériels et non par des logiques industrielles de marché. C’est expression de besoin et les marchés passés sur le MCO doivent tenir compte de la façon dont on utilise les matériels et non répondre à des logiques industrielles de marché. C’est en fait une question de philosophie, car nous avons au départ passé des contrats où on payait à la réparation, alors que la philosophie la plus incitative est de ne payer que quand on vole. Je crois beaucoup à la possibilité de faire avancer toutes ces questions qui nous permettront à la fois de maîtriser les coûts et de mieux maîtriser un MCO tiré par l’activité, en commençant par clarifier notre structure au sein de l’armée de l’air. Nous avons en effet actuellement une structure un peu double, avec d’un côté la SIMMAD (Structure interarmées de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense), structure interarmées passant les marchés, et de l’autre, le CSFA (Commandement du soutien des forces aériennes), davantage tourné vers les forces et le soutien.
Ces structures maintenant co-localisées à Bordeaux travaillent en synergie notamment autour de plateaux techniques réunissant les forces et les industriels, mais le projet de l’armée de l’air que l’on va mettre en œuvre prévoit d’aller plus loin, par souci de clarté, en faisant de la SIMMAD l’unique point d’entrée du dialogue avec les forces, la DGA pour une intégration du MCO dans les expressions de besoins des nouveaux programmes, mais aussi les industriels, qui sont à la fois des industriels privés et des industriels étatiques sous l’égide du SIAé (Service industriel de l’aéronautique). A noter qu’au sein des AIA (ateliers industriels aéronautiques), nous disposons d’une part de personnels civils de grande qualité (et souvent très motivés pour partir en OPEX) et de personnels militaires moins polyvalents que dans des affectations plus classiques, mais à même d’acquérir une vraie compétence qui nous servira ultérieurement. Nous sommes de fait en train de réfléchir à la façon d’optimiser ce processus en nous interrogeant en amont sur le type de connaissances à acquérir. Le CSFA, issu au départ d’AIR 2010, va quant à lui fusionner sous un seul commandement des forces aériennes (CFA) à partir de cet été.
Il est fondamental pour notre organisation que l’opérationnel soit au centre de l’expression du besoin. Cette expression de besoin et les marchés passés sur le MCO doivent tenir compte de la façon dont on utilise les matériels et non répondre à des logiques industrielles de marché.
Un juste coût pour un juste soutien : encourager l’esprit d’innovation
Le reproche fait selon lequel les coûts de MCO ne diminuent pas à mesure que la flotte se réduit est faux, dès lors que l’on raisonne en euros courants. Il est évident que le MCO a un coût et qu’avec la diminution des équipements le monde industriel pourrait naturellement essayer d’augmenter la facture sur ce secteur-là. Le problème est donc d’établir le juste coût, c’est-à-dire celui lié à notre juste activité. C’est pourquoi le lien avec les forces est donc indispensable à mes yeux. Dans le cadre de la réorganisation en cours, des officiers des forces, spécialistes du soutien, sont dorénavant insérés dans les EDPI (équipes de programme intégrés, dès le lancement d’un programme, de façon à ce qu’ils puissent dorénavant participer à l’expression de besoin aux côtés de la DGA (Délégation générale de l’armement) en charge de passer le nouveau contrat, lequel comprend le MCO, mais aussi tous les approvisionnements initiaux.
Cette évolution, de concert avec la concentration de tous les acteurs sur Bordeaux et la redynamisation des plateaux techniques en accord avec les industriels, doit permettre à l’ensemble de la structure de porter ses fruits, mais à condition de la laisser tourner pendant au moins deux ans sans y toucher. Si on modifie encore l’organisation, car il y a une volonté de changement permanent, il est certain que cela ne marchera jamais. Je crois beaucoup à ces structures et tout le monde s’est retroussé les manches pour que cela marche.
Nous avons de fait déjà à notre actif de beaux exemples d’approches innovantes, telles que le marché Météor passé avec Thales par la SIMMAD : il s’agit d’un marché d’un genre nouveau, assez transverse puisqu’il couvre différents produits, et au sein duquel l’impératif de maîtrise des coûts a été bien pris en compte par le biais de solutions novatrices (les industriels vont notamment avoir des guichets sur certaines de nos bases aériennes afin de faciliter les échanges). Il s’agit donc d’un bon premier exemple et j’espère que cela va en appeler d’autres. Il est certain que l’on ne parlera pas de MCO de façon cohérente, si nous n’avons pas un véritable dialogue avec les industriels, que ce soit l’industrie étatique qui est indispensable pour moi, ou les industriels privés.
Le MCO est donc pour moi une très grande priorité et l’un des axes centraux du projet que l’on a programmé pour l’armée de l’air.
Nouveaux équipements : intégrer la gestion de configuration en matière de MCO
Si l’arrivée de nouveaux équipements conjuguée aux réductions favorise une plus grande homogénéité de la flotte et donc une certaine simplification en matière de MCO, il faut être conscient du fait qu’il y a un risque à ne dépendre que de mono-flottes, car nous ne sommes jamais à l’abri d’une surprise technique. L’autre aspect est qu’avec l’introduction de systèmes modernes, on a beaucoup à apprendre en matière de maintenance. Je pense en particulier à l’A400M : c’est un avion magnifique, dont la maintenance a été conçue de manière très différente des générations précédentes d’avions de transport. Nous avons besoin de nous approprier la maintenance de l’A400M et de la faire évoluer de la même façon que nous faisons évoluer l’armement. Nous avons des années pour le faire comme c’est le cas encore aujourd’hui avec le Rafale, sur lequel nous n’arrêtons pas de faire évoluer l’armement pour nous adapter, mais où, curieusement, nous restons un peu timorés en matière de MCO. Or il est essentiel que le MCO suive et ce sera le cas sur l’A400M, ce qui sera un peu compliqué au début, mais la difficulté tient au fait que nous avons besoin d’apprendre à fonctionner différemment. La partie maintenance a été trop négligée lors des études initiales et il est important que la SIMMAD et l’EMA disposent d’une force de frappe prospective solide permettant de prendre du recul au-delà de la gestion quotidienne, ce qui sera fait cet été de la même façon que nous le faisons déjà au niveau de l’acquisition et de l’utilisation des équipements. Il convient ainsi d’envisager de nouveaux modes de fonctionnement en corrélation avec l’activité.
Un MCO corrélé au concept d’emploi
Pour que l’activité puisse tirer le MCO et non l’inverse, le MCO doit rester au cœur de l’activité, en lien avec cette dernière et la manière dont nous la percevons. Un Rafale ne s’utilise pas comme un Mirage 2000, un A400M ne s’utilisera pas comme un C160, un Mamba n’est pas un Crotale, etc… Mon but est donc d’inciter l’armée de l’air à se montrer la plus imaginative possible dans l’utilisation de ces matériels, qui sont extraordinaires et nous permettent de multiples innovations devant aller de pair avec la manière de gérer la maintenance. L’activité d’un drone par exemple n’a rien de commun avec celle d’un avion : en opération, nous devons faire énormément voler les drones, ce qui n’est pas le cas en métropole, dans la mesure où le système au sol permet de nous entraîner sans avoir besoin de le faire beaucoup voler. Il ne faut donc pas passer le même type de contrat MCO que pour un avion dont l’activité est fondamentalement différente.
Autre exemple : celui de l’A400M, que l’on va essayer d’utiliser, en raison de sa soute, davantage à partir du territoire national, plutôt que de le pré-positionner pour faire du brouettage entre le Gabon et le Tchad par exemple. Qui dit capacités de fonctionnement différentes, dit utilisation des moteurs différente, etc. Il va donc falloir que nous soyons innovants pour que le MCO colle à cette activité-là, de façon à bien maîtriser les coûts.
Afin d’encourager un œil neuf et cet esprit d’innovation, il faut à mon sens encourager deux choses :
1) le développement de parcours croisés entre équipages : c’est ce que nous faisons déjà avec l’A400M, où l’unité de départ inclue des personnels venant du Transall, de l’Hercules, des Airbus, mais aussi du Rafale. Nous sommes en train de mettre un pilote de Rafale sur l’A400M, précisément pour apporter un autre éclairage ;
2) l’intégration immédiate des jeunes : l’avantage des jeunes qui n’ont pas l’expérience des autres est qu’ils posent parfois les bonnes questions, ce qui se vérifie dans tous les domaines y compris dans la maintenance.
Vers un entraînement différencié
Les équipages, un facteur dimensionnant pour les missions opérationnelles.
Lié à la problématique du MCO existe un autre vrai sujet, qui est celui de l’entraînement : toutes les armées de l’air dotées de matériels modernes connaissent le même problème, à savoir le coût de l’entraînement. Il faut bien comprendre est que ce dernier est fonction des capacités : en ce qui concerne les capacités de combat, les aviateurs ne s’entraînent pas pendant la mission, ce qui n’est pas toujours le cas des capacités de transport où il est possible de profiter de missions réelles en assignant un pilote en formation à des missions logistiques aux côtés d’un pilote formé moniteur.<br />Pour l’aviation de chasse en particulier, le facteur dimensionnant est donc l’équipage.
Nous avons donc besoin d’avoir des équipages pour nos missions et pour les avoir il faut les entraîner. Pour les entraîner, il faut des avions : une partie du parc est donc dimensionnée pour entraîner les équipages en nombre suffisant, ce qui est parfois source d’incompréhensions (« pourquoi tant d’avions pour en déployer 45 ? »). Nous nous astreignons donc aujourd’hui à réfléchir à d’autres méthodes pour essayer d’optimiser l’entraînement, à partir d’une différenciation de ce dernier en deux cercles complémentaires :
1) un premier cercle d’équipages extrêmement bien entraînés qui feraient partie de la mission du premier jour, lesquelles sont toujours les plus dangereuses (c’est la mission du 19 mars sur Benghazi; c’est la mission du 13 janvier sur le Mali…), et nous avons besoin de personnels au mieux de leur forme et de leur entraînement requérant plus que 100 heures de vole minimum de 180 heures de vol par an;
2) un second cercle d’équipages qui ont été très opérationnels, et qui seraient en mesure de prendre la relève des premiers pour des missions plus routinières, une fois la supériorité aérienne acquise sur le théâtre : l’entraînement se ferait sur un autre type d’avion un peu moins cher, mais leur permettant en deux mois de relever le premier cercle.
D’où la rénovation de notre outil de formation de toutes façons indispensable et actuellement déjà en cours pour la chasse. Il existe de fait actuellement sur le marché des avions plus modernes que l’on peut configurer au niveau des commandes de vol et de visualisation comme un Rafale et qui nous permettrait d’une part de moderniser la formation et d’autre part de compléter l’entraînement des pilotes de deuxième cercle : ces derniers feraient donc un peu moins de Rafale et un peu plus de cet avion-là et seraient en conséquence entraînés à moindre coût, tout en restant opérationnels et utilisables en seconde partie d’une opération. Cela nous permettrait d’économiser énormément et nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à étudier ce concept, que nous commençons à mettre en place : ce n’est pas que de la formation, c’est de la formation et de l’entraînement différenciés, ce qui se faisait déjà implicitement un peu en ce qui concerne les avions de transport, où l’entraînement ne va pas être le même entre un transport logistique classique, lequel ne demande pas le même niveau de formation que l’acquisition de capacités tactiques pures nécessaires par exemple pour un poser d’avion de nuit sur 900 mètres de piste tel que ce fut le cas à Gao. Il ne s’agit pas du même genre d’entraînement et, sous peine de la poursuite de la réduction des formats, il faut se poser un certain nombre de questions : doit-on entraîner tous les pilotes à tout faire ? Doit-on entraîner un premier cercle avec un deuxième cercle disposant des connaissances minimales pour éventuellement remonter en puissance ? De mon point de vue, il est préférable de prendre acte des réductions, mais de continuer à avoir une capacité opérationnelle réelle en menant cette réflexion.
« De mon point de vue, il est préférable de prendre acte des réductions, mais de continuer à avoir une capacité opérationnelle réelle en menant cette réflexion [sur la formation et l’entraînement différenciés]. »
Les exigences de la polyvalence et l’avenir prometteur de l’entraînement en environnement synthétique.
Par ailleurs, si on investit au bon niveau, l’apport de la simulation permet aujourd’hui d’aller beaucoup plus loin, notamment en implémentant des situations réelles en vol. Nous disposons par exemple d’un polygone de guerre électronique implanté à moitié en France et à moitié en Allemagne et doté de simulateurs de missiles. Nous serons bientôt capables de faire a même chose grâce aux liaisons de données : un centre de contrôle pourra implémenter une situation de missiles que le pilote recevra dans son avion, comme si elle était réelle, alors qu’elle aura été générée fictivement : je vois bien de fait une évolution du rôle des contrôleurs dans ce domaine de la défense aérienne. La technique nous permet d’opposer des personnels en vol et des personnels sur simulateur.
Nous devons investir et mettre sur pied de vrais concepts, sans oublier le facteur humain, le mélange du réel et du fictif devant être géré avec attention. Il s’agit là d’un axe d’effort véritable destiné à améliorer notre entraînement à moindre coût, et les capacités d’innovation dans ce domaine sont aujourd’hui très importantes.
La mission du 13 janvier effectuée par quatre Rafale a démontré les capacités d’élongation de cet avion : les pilotes ont fait 9h35 de vol, ont attaqué des objectifs sur Gao en quittant Saint-Dizier et ont dû reprogrammer une partie de l’attaque en vol. Pour réaliser une telle mission et faire en plus une mission de reconnaissance le lendemain, il faut entre 220 et 250 heures de vol si on veut qu’un pilote de Rafale soit bien entraîné compte tenu de la polyvalence de l’avion. Dans la mesure où le simulateur de Saint-Dizier est performant, le nombre d’heures de vol a été ramené à 180 (qui était la norme OTAN pour des avions moins polyvalents), mais on ne peut pas descendre en dessous. Malheureusement, nous n’avons pas les moyens d’assurer un tel niveau d’entraînement à tous les pilotes et ceux ne l’ayant pas ne pourront pas faire ces missions-là, d’où l’idée non seulement de différencier, mais aussi de faire tourner entre les cercles les pilotes, car nous avons besoin d’aviateurs de ce niveau. Caractéristique de la polyvalence, un pilote nucléaire a reçu dernièrement des mains du Ministre de la défense la croix de la valeur militaire pour cinq actions d’éclat extraordinaires réalisées au Mali. Si on fait descendre ce pilote en dessous de 180 heures de vol, on ne l’emmènera plus au Mali, et on le consacrera à sa spécialité de pilote nucléaire, ce qui serait dommage, car on perdrait cette capacité de polyvalence de l’avion. C’est bien face à un tel constat que l’on a réduit les formats, aussi le pire aujourd’hui serait-il que l’on ait réduit les formats sans tirer les leçons sur le reste. Ces formats vont encore être réduits au niveau avions de combat, mais le pendant est d’assurer un niveau d’activité suffisant pour tourner correctement. Charge à nous d’être intelligents pour définir ce dernier, ne pas entraîner tout le monde de la même façon et maîtriser les coûts.
L’armée de l’air face à Serval : le RETEX du CEMAA
L’innovation au service de Serval
L’opération au Mali a-t-elle été facteur de changement au niveau du tandem « pilote-mécanicien» ?
Les changements ne viennent pas du Mali, mais de la capacité du Rafale notamment et des nouveaux systèmes. Le Rafale ne se gère pas de la même façon que les autres avions, comme par exemple en raison de sa faculté à s’autotester. Parce que cet avion est différent, il faut travailler différemment et tirer parti de ses remarquables évolutions technologiques. Compte tenu de la très grande variété de configurations du Rafale, nous avons regroupé tous les mécaniciens, jusqu’alors répartis dans chaque escadron, au sein d’une même unité. Nous avions en effet besoin d’une gestion globale, car chaque escadron n’aurait pas aujourd’hui la capacité de gérer la totalité des changements de configurations. Nos retours d’expérience ont mis en avant la nécessité de placer sous un même commandement pilotes et mécaniciens, comme cela se fait en opérations extérieures. C’est pourquoi nous allons remettre sous une même autorité les pilotes et les mécaniciens, qui retrouveront cette identité commune. Cela fait partie du projet armée de l’air où nous sommes ainsi en train de travailler sur la création d’une nouvelle structure d’escadres. J’aime bien le terme d’escadre parce qu’il a une identité qui s’exprime par des drapeaux, des traditions. Il ne s’agit pas d’un retour en arrière, mais bien d’une évolution logique en fonction des retours d’expérience des opérations réelles et aussi des nouveaux systèmes sur lesquels il nous faut continuer à apprendre. Par ailleurs à un moment, nous avions diminué le nombre de mécaniciens par avion, et nous nous sommes aperçus que des réajustements s’avéraient nécessaires. C’est ce que nous nous attachons à faire. Il n’est pas anormal que nous ayons fait quelques erreurs. Ce qui serait anormal serait de ne pas les corriger.
L’armée de l’air a-t-elle rencontré des difficultés particulières en matière de MCO au Mali, étant donné la nature de ce théâtre ?
Nous avons eu d’une façon générale une très, très bonne disponibilité parce que nous nous donnons les moyens de l’obtenir. Nous avons maintenant une bonne connaissance des problèmes rencontrés (notamment par notre expérience africaine), laquelle nous permet d’avoir l’autonomie nécessaire des équipages et la capacité de réagir en trouvant les bonnes solutions pour soit réparer sur place, soit être capable de convoyer un avion dans des conditions acceptables en termes de sécurité afin d’être réparé ailleurs. Nos équipages, nos mécaniciens, font preuve de beaucoup de “système D” à bon escient, ce qui témoigne de la qualité de notre personnel et de son esprit d’adaptation. Et le Rafale supporte très bien les températures africaines. Les problèmes de maintenance que nous avons rencontrés pendant Serval sont connus : ils sont liés à l’âge de certains matériels. Tout d’abord le C135, matériel le plus vieux de toutes les armées françaises, qui a une disponibilité malgré tout correcte, parce que nous avons des personnels remarquables qui travaillent extrêmement durs pour faire face aux pannes qui sont nombreuses. Mais c’est presque de l’acharnement thérapeutique. Maintenir cette capacité nous coûte cher en moyens et en hommes, mais elle est absolument indispensable. Il en est de même pour le Transall, qui accuse également le poids des années.
Notre grand manque dans cette opération est de trois ordres :
- – le ravitaillement en vol,
- – le transport notamment tactique,
- – et notre capacité de surveillance.
Concernant ce dernier point, je souligne que c’est la première fois que nous emmenons tout notre escadron de drones Harfang en OPEX. C’est une bonne illustration de notre manque de drones. Trois Harfang sur quatre sont opérationnels et volent beaucoup. Ils nous apportent une capacité extrêmement importante de permanence sur le théâtre. Le problème des drones, c’est que plus on en a, plus on en a besoin ! Nous avons bénéficié de 100 % de disponibilité, mais notre problème est que les Harfang n’avaient pas été prévus pour être opérationnel au départ et que nous consommons rapidement tout leur potentiel si nous les utilisons trop.
Ces lacunes capacitaires ont pu être comblées grâce aux contributions de nos alliés : comment s’est faite l’intégration de ces capacités aériennes pendant Serval ?
Nous avons depuis longtemps l’habitude de travailler avec les alliés dans les structures de commandement et de contrôle – et l’interopérabilité sera encore meilleure avec l’ACCS (NATO Air Command-and-Control System) – aux normes OTAN et en anglais. Dès le déclenchement des opérations et lorsque le CEMA nous a délégué la planification et la conduite des opérations aériennes, sous son commandement, il a fallu réorganiser tout l’espace aérien du Mali en l’absence de radars et en prenant en compte le fait que nous décollions de six pays différents avec des élongations énormes (de N’Djamena au nord du Mali, c’est l’équivalent en distance de Istanbul-la France). Nous avons organisé l’espace aérien (Air Space Coordination Order), les instructions, la manière de planifier les opérations, le concept d’opération aux normes OTAN. Ce fut la première question de nos principaux alliés – je pense notamment aux Américains et aux Anglais, mais de nombreux autres pays nous ont également aidés – lorsqu’ils sont venus nous voir : « Comment avez-vous organisé tout cela ? ». Nous leur avons montré et pour la première fois ils sont passés sous notre contrôle, ce qui constitue une grande première et la reconnaissance d’un niveau de crédibilité acquis au fil du temps : ils nous connaissent, reconnaissent notre capacité à diriger des opérations aériennes complexes, sinon ils ne seraient pas venus. Toute cette coordination s’effectue pour la première fois au sein d’une opération commandée par la France et c’est cela qui est formidable. Les Américains ont apporté de nombreux moyens de transport, de ravitaillement, mais aussi de renseignement sur lesquels il y a beaucoup de partage. Notre centre des opérations aériennes de Lyon accueille aujourd’hui des officiers de liaison britanniques, canadiens, américains et, pour tout ce qui concerne le transport, nous avons des Danois, des Allemands, des Espagnols au CAOC (Combined Air Operations Center) que nous avons installé à N’Djamena.
Au départ le JFACC (Joint Force Air Component Commander) était une petite cellule, dont l’origine est antérieure à Serval et liée à un besoin de coordonner nos moyens aériens de transport : nous l’avons installée le 23 décembre, car nous nous étions aperçus que nous avions besoin de coordonner les moyens en C160 et C130 pré-positionnés en Afrique sur différents théâtres et utilisés par différents commandements supérieurs, de façon à ce qu’il y ait une meilleure optimisation de ces moyens. Bien nous en a pris, car juste après Noël, les crises en RCA ont montré toute la pertinence d’avoir cette conduite optimisée en l’occurrence de N’Djamena. Puis en janvier, lors des opérations, le JFACC de Lyon est monté en puissance : nous avons gardé toute la partie planification à Lyon et avons installé la partie conduite à N’Djamena. Sur les grosses opérations, Lyon reprenait la conduite sous les ordres du CPCO (centre de planification et de conduite des opérations). En ce qui concerne l’opération de Tombouctou, une grosse opération qui a impliqué une quarantaine d’avions – car nous avions, en plus des avions de transport, un appui chasse, des ravitailleurs en vol, des drones, des ATL2 de la Marine, un AWACS – nous avons repris la conduite à partir de Lyon, mais sinon, pour les autres missions, la conduite s’est faite à N’Djamena : il est possible de basculer instantanément de l’un à l’autre. C’est la première fois que nous faisions cela et cela fonctionne en nous donnant une flexibilité incroyable pour répondre aux demandes du chef d’état-major des armées.
En ce qui concerne l’opération de Tombouctou, une grosse opération qui a impliqué une quarantaine d’avions – car nous avions, en plus des avions de transport, un appui chasse, des ravitailleurs, des drones, des ATL2 de la Marine, un AWACS – nous avons repris la conduite à partir de Lyon, mais sinon, pour les autres missions, la conduite s’est faite à N’Djamena : il est possible de basculer instantanément de l’un à l’autre.
Nous avons pu faire cela, parce que la force de l’armée de l’air est de s’être construite sur ses deux missions permanentes depuis les années soixante, à savoir la défense aérienne et les forces aériennes stratégiques, lesquelles nous ont permis de développer des structures de commandement et de conduite extrêmement robustes, avec des capacités d’architecture de réseaux de systèmes d’informations et de communications élaborés. Nous avons développé une grande réactivité et une permanence de nos bases aériennes et centres de contrôle capables de basculer instantanément du temps de paix au temps de crise. Nos bases aériennes sont déjà en alerte appuyées par ces réseaux et par ces centres de planification, de commandement et de conduite des opérations. Ainsi toute notre réactivité pour les OPEX s’est construite autour de ces deux missions permanentes. C’est cela qui nous a donné notre force, tandis que les forces aériennes stratégiques nous ont en plus habitués à planifier et conduire ces opérations complexes à partir du territoire national, pour agir très loin, avec une grande réactivité. C’est ce qui nous a permis d’arriver au niveau où nous sommes aujourd’hui. Nous n’aurions pas eu ces missions permanentes, nous n’aurions pas ce niveau et cette capacité qui aujourd’hui sont assez uniques.
L’A400M aurait également pu compenser le manque capacitaire en transport stratégicotactique que vous évoquiez tout à l’heure : pensez-vous tester le premier que vous vous apprêtez à accueillir au Mali et, si vous l’aviez eu pour Serval, quel en aurait été l’impact sur les opérations ?
Le premier A400M arrivera normalement cet été dans l’armée de l’air et nous devrons le mettre en oeuvre avant de le déployer en opérations. Nos équipages et mécaniciens ont été formés et nous disposons même d’une unité multinationale pour la réception des premiers appareils. Si nous avions eu cet appareil au plus fort de Serval, notre vision de la logistique aurait été considérablement modifiée.
Au Mali, nous utilisons nos avions stratégiques et tactiques de transport de deux façons : d’une part à travers un apport logistique stratégique, d’autre part à travers une grande capacité tactique, laquelle nous a permis de larguer près de 300 parachutistes sur Tombouctou, de prendre de vive force un certain nombre de terrains grâce à des posés d’assaut, etc. Or, la principale caractéristique de l’A400M est sa capacité logistique remarquable associée à des capacités de poser tactique : là où se pose un Hercules, se pose un A400M, et ce dernier fait même mieux avec une soute beaucoup plus grosse et un emport beaucoup plus important.
Il est sûr que, grâce à ses moteurs puissants qui lui permettent de se poser sur des distances extrêmement courtes, il aurait pu se poser sur la plupart des terrains du Nord-Mali où nous sommes allés en apportant la logistique directement de France, ce que nous n’avons pas pu faire, et qui aurait encore accru notre réactivité. Une des difficultés que nous rencontrons aujourd’hui est en effet la rupture de charge : quand sont survenus les combats menés par l’armée de terre dans le nord du Mali, un ravitaillement en eau extrêmement important était nécessaire (environ 10 litres par homme par jour). Toute cette logistique venait de France sur Bamako avec l’aide d’avions de nos pays alliés et d’affrètements. Une fois arrivés à Bamako, ces gros avions de transport devaient être déchargés pour que la logistique soit acheminée par des avions tactiques plus adaptés aux terrains du nord. Cette rupture de charge nous a coûté extrêmement cher dans le tempo des opérations.
Un A400M venant de France aurait pu se poser directement sur les terrains du nord, ce qui nous aurait changé complètement la vie. De la même façon, quand nous avons réalisé l’opération de parachutage sur Tombouctou, discrétion oblige, nous avons regroupé les avions de transport sur Abidjan, qui était suffisamment éloigné du théâtre et nous avons fait venir des troupes de France dans un souci de discrétion : là encore, l’A400M aurait pu faire l’aller-retour avec une discrétion totale avec une réactivité accrue, ce qui pour moi est fondamental pour l’armée de l’air. On part de France et on revient se reposer chez nous… De ce point de vue, l’A400M apporte des capacités extrêmement performantes et il aurait pu être utilisé différemment sans pré-positionnement, en raison de sa capacité d’élongation et de transport qui est incroyable, et une soute fantastique de surcroît.
De fait, en ce qui concerne nos bases pré-positionnées, nous n’avons pas besoin d’y être en permanence avec de gros effectifs ; nous avons simplement besoin de points d’appui avec une présence minimale. Aujourd’hui, notre présence est liée à notre manque d’un moyen de transport disposant d’une élongation à fort rayon d’action. Demain l’A400M permettra d’être moins présent, mais avec une activité plus importante : Paris-N’Djamena, ce sont deux jours de Transall avec une capacité d’emport de huit tonnes ; en A400M, c’est moins de huit heures et vingt-cinq tonnes… cela change un peu la façon dont on voit les choses ! Au niveau MCO, la formation des mécaniciens a commencé, une des questions étant la prise de compétence par le SIAé, laquelle est importante pour nous, car elle nous positionne dans un vrai savoirfaire. Nous aurons en effet beaucoup à apprendre sur l’avion, qui va subir des évolutions, et aussi sur les moteurs, qui sont très innovants : nous devrons nous familiariser avec la manière dont on les gère et dont on les répare, et il nous faut être très ouverts à l’innovation. L’enjeu est bien sûr d’avoir suffisamment de ces appareils et aussi d’avoir la structure de planification et de conduite des opérations qui nous permet d’opérer depuis la France : ainsi que je l’ai évoqué, nous avons démontré avec le Mali que les opérations aériennes étaient planifiées et pour une part conduites depuis le centre national des opérations de Lyon. C’est aussi cela qui nous permet d’être sûrs d’avoir ce niveau de réactivité, car avoir des avions est une chose, mais si vous n’avez pas cette capacité à planifier et à conduire les opérations, cela ne sert à rien. Or cette capacité, nous l’avons…
Crédits photos © Sylvain Ramadier, Airbus Military, novembre 2009